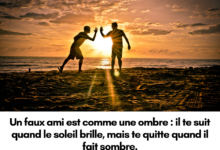Poème d’amitié inspiré de Voltaire : des mots empreints de sagesse et d’émotion
Sommaire
Poème d’amitié voltaire
LE TEMPLE DE L’AMITIÉ
Séjour heureux, de la cour ignoré,
S’élève un temple, où l’art et ses prestiges
N’étalent point l’orgueil de leurs prodiges,
Où rien ne trompe et n’éblouit les yeux,
Où tout est vrai, simple, et fait pour les dieux.
De bons gaulois de leurs mains le fondèrent ;
A l’Amitié leurs cœurs le dédièrent.
Las ! Ils pensaient, dans leur crédulité,
Que par leur race il serait fréquenté.
En vieux langage on voit sur la façade
Les noms sacrés d’Oreste et de Pylade,
Le médaillon du bon Pirithoüs,
Du sage Achate et du tendre Nisus,
Tous grands héros, tous amis véritables :
Ces noms sont beaux, mais ils sont dans les fables.
Les doctes Sœurs ne chantent qu’en ces lieux,
Car on les siffle au superbe empyrée.
On n’y voit point Mars et sa Cythérée,
Car la Discorde est toujours avec eux :
L’Amitié vit avec très peu de dieux.
A Mme du Châtelet
Rendez-moi l’âge des amours ;
Au crépuscule de mes jours
Rejoignez, s’il se peut, l’aurore.
Des beaux lieux où le dieu du vin
Avec l’Amour tient son empire,
Le Temps, qui me prend par la main,
M’avertit que je me retire.
De son inflexible rigueur
Tirons au moins quelque avantage.
Qui n’a pas l’esprit de son âge,
De son âge a tout le malheur.
Laissons à la belle jeunesse
Ses folâtres emportements.
Nous ne vivons que deux moments :
Qu’il en soit un pour la sagesse.
Quoi ! pour toujours vous me fuyez,
Tendresse, illusion, folie,
Dons du ciel, qui me consoliez
Des amertumes de la vie !
On meurt deux fois, je le vois bien :
Cesser d’aimer et d’être aimable,
C’est une mort insupportable ;
Cesser de vivre, ce n’est rien. “
Ainsi je déplorais la perte
Des erreurs de mes premiers ans ;
Et mon âme, aux désirs ouverte,
Regrettait ses égarements.
Du ciel alors daignant descendre,
L’Amitié vint à mon secours ;
Elle était peut-être aussi tendre,
Mais moins vive que les Amours.
Touché de sa beauté nouvelle,
Et de sa lumière éclairé,
Je la suivis; mais je pleurai
De ne pouvoir plus suivre qu’elle.
Aux manes de M. de Genonville
Toi que le ciel jaloux ravit dans son printemps,
Toi de qui je conserve un souvenir fidèle
Vainqueur de la mort et du temps,
Toi dont la perte, après dix ans,
M’est encore affreuse et nouvelle ;
Si tout n’est pas détruit, si sur les sombres bords
Ce souffle si caché, cette faible étincelle,
Cet esprit, le moteur et l’esclave du corps,
Ce je ne sais quel sens qu’on nomme âme immortelle,
Reste inconnu de nous, est vivant chez les morts ;
S’il est vrai que tu sois, et si tu peux m’entendre,
Ô mon cher Genonville, avec plaisir reçois
Ces vers et ces soupirs que je donne à ta cendre,
Monument d’un amour immortel comme toi.
Il te souvient du temps où l’aimable Egérie,
Dans les beaux jours de notre vie,
Ecoutait nos chansons, partageait nos ardeurs.
Nous nous aimions tous trois ; la raison, la folie,
L’amour, l’enchantement des plus tendres erreurs,
Tout réunissait nos trois cœurs.
Que nous étions heureux ! même cette indigence,
Triste compagne des beaux jours,
Ne put de notre joie empoisonner le cours.
Jeunes, gais, satisfaits, sans soins, sans prévoyance,
Aux douceurs du présent bornant tous nos désirs,
Quel besoin avions-nous d’une vaine abondance ?
Ces plaisirs, ces beaux jours coulés dans la mollesse,
Ces ris, enfants de l’allégresse,
Sont passés avec toi dans la nuit du trépas.
Le ciel, en récompense, accorde à ta maîtresse
Des grandeurs et de la richesse,
Appuis de l’âge mûr, éclatant embarras
Faible soulagement quand on perd sa jeunesse.
La fortune est chez elle où fût jadis l’amour.
Les plaisirs ont leur temps ; la sagesse a son tour.
L’amour s’est envolé sur l’aile du bel âge ;
Mais jamais l’amitié ne fuit du cœur du sage.
Nous chantons quelquefois et tes vers et les miens ;
De ton aimable esprit nous célébrons les charmes ;
Ton nom se mêle encore à tous nos entretiens ;
Nous lisons tes écrits, nous les baignons de larmes :
Loin de nous à jamais ces mortels endurcis,
Indignes du beau nom, du nom sacré d’amis,
Ou toujours remplis d’eux, ou toujours hors d’eux même,
Au monde, à l’inconstance ardents à se livrer,
Malheureux, dont le cœur ne sait pas comme on aime,
Et qui n’ont point connu la douceur de pleurer !
La Bastille
En beau printemps, un jour de Pentecôte,
Qu’un bruit étrange en sursaut m’éveilla.
Un mien valet, qui du soir était ivre:
« Maître, dit-il, le Saint-Esprit est là;
C’est lui sans doute, et j’ai lu dans mon livre
Qu’avec vacarme il entre chez les gens. »
Et moi de dire alors entre mes dents:
« Gentil puîné de l’essence suprême,
Beau Paraclet, soyez le bienvenu;
N’êtes-vous pas celui qui fait qu’on aime?
En achevant ce discours ingénu,
Je vois paraître au bout de ma ruelle,
Non un pigeon, non une colombelle,
De l’Esprit saint oiseau tendre et fidèle,
Mais vingt corbeaux de rapine affamés,
Monstres crochus que l’enfer a formés.
L’un près de moi s’approche en sycophante:
Un maintien doux, une démarche lente,
Un ton cafard, un compliment flatteur,
Cachent le fiel qui lui ronge le coeur.
« Mon fils, dit-il, la cour sait vos mérites;
On prise fort les bons mots que vous dites,
Vos petits vers, et vos galants écrits;
Et, comme ici tout travail a son prix,
Le roi, mon fils, plein de reconnaissance,
Veut de vos soins vous donner récompense,
Et vous accorde, en dépit des rivaux,
Un logement dans un de ses châteaux.
Les gens de bien qui sont à votre porte
Avec respect vous serviront d’escorte;
Et moi, mon fils, je viens de par le roi
Pour m’acquitter de mon petit emploi.
¾ Trigaud, lui dis-je, à moi point ne s’adresse
Ce beau début; c’est me jouer d’un tour:
Je ne suis point rimeur suivant la cour;
Je ne connais roi, prince, ni princesse;
Et, si tout bas je forme des souhaits,
C’est que d’iceux ne sois connu jamais.
Je les respecte, ils sont dieux sur la terre;
Mais ne les faut de trop près regarder:
Sage mortel doit toujours se garder
De ces gens-là qui portent le tonnerre.
Partant, vilain, retournez vers le roi;
Dites-lui fort que je le remercie
De son logis; c’est trop d’honneur pour moi;
Il ne me faut tant de cérémonie:
Je suis content de mon bouge; et les dieux
Dans mon taudis m’ont fait un sort tranquille:
Mes biens sont purs, mon sommeil est facile,
J’ai le repos; les rois n’ont rien de mieux.
J’eus beau prêcher, et j’eus beau m’en défendre,
Tous ces messieurs, d’un air doux et bénin,
Obligeamment me prirent par la main:
« Allons, mon fils, marchons. » Fallut se rendre,
Fallut partir. Je fus bientôt conduit
En coche clos vers le royal réduit
Que près Saint-Paul ont vu bâtir nos pères
Par Charles Cinq. O gens de bien, mes frères,
Que Dieu vous gard’ d’un pareil logement!
J’arrive enfin dans mon appartement.
Certain croquant avec douce manière
Du nouveau gîte exaltait les beautés,
Perfections, aises, commodités.
« Jamais Phébus, dit-il, dans sa carrière,
De ses rayons n’y porta la lumière:
Voyez ces murs de dix pieds d’épaisseur,
Vous y serez avec plus de fraîcheur. »
Puis me faisant admirer la clôture,
Triple la porte et triple la serrure,
Grilles, verrous, barreaux de tout côté:
« C’est, me dit-il, pour votre sûreté. »
Midi sonnant, un chaudeau l’on m’apporte;
La chère n’est délicate ni forte:
De ce beau mets je n’étais point tenté;
Mais on me dit: « C’est pour votre santé;
Mangez en paix, ici rien ne vous presse. »
Me voici donc en ce lieu de détresse,
Embastillé, logé fort à l’étroit,
Ne dormant point, buvant chaud, mangeant froid,
Trahi de tous, même de ma maîtresse.
O Marc-René, que Caton le Censeur
Jadis dans Rome eût pris pour successeur,
O Marc-René, de qui la faveur grande
Fait ici-bas tant de gens murmurer,
Vos beaux avis m’ont fait claquemurer:
Que quelque jour le bon Dieu vous le rende!